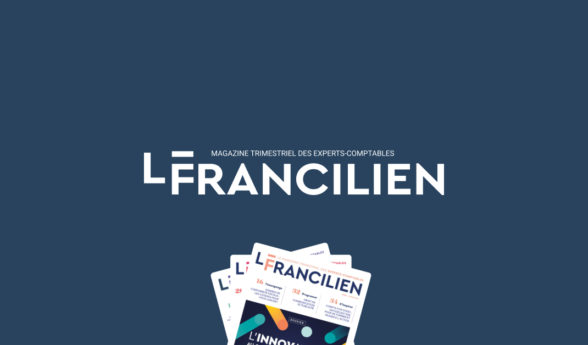Retour sur nos événements
Découvrir les événements à venir
du 06/09/2022 au 08/09/2022
Le grand test de l'été : quel UE-Phile êtes-vous ?
Test psycho pour savoir quel participant des UE vous êtes

du 06/09/2022 au 08/09/2022
Universités d'été 2022 - Infos pratiques
Infos pratiques pour les Universités d'été 2022

du 06/09/2022 au 08/09/2022
La parole aux partenaires
Les partenaires des Universités d'été 2022 vous donnent rendez-vous les 6,7 et septembre 2022 au Palais des Congrès de Paris.

du 08/09/2022 au 08/09/2022
Grande conférence : Renaissance (Jeudi 8 septembre, 16h-18h)
La grande conférence des Universités d'été 2022 de la profession comptable francilienne porte sur la "Renaissance"

du 06/09/2022 au 07/09/2022
Les temps forts
Les temps forts des Universités d'été 2022 de la profession comptable francilienne, ateliers à ne pas manquer !

du 08/09/2022 au 09/09/2022
Les ateliers à la carte des Universités d'été 2022 - Jeudi 8 septembre 2022
Les ateliers à la carte des Universités d'été de la journée du jeudi 8 septembre 2022 de la profession comptable francilienne.

du 07/09/2022 au 07/09/2022
Les ateliers à la carte des Universités d'été 2022 - Mercredi 7 septembre 2022
Les ateliers à la carte des Universités d'été de la journée du mercredi 7 septembre 2022 de la profession comptable francilienne.

du 06/09/2022 au 06/09/2022
Les ateliers à la carte des Universités d’été 2022 – Mardi 6 septembre 2022
Retrouvez les ateliers à la carte des Universités d’été 2022 de la journée du mardi 6 septembre 2022

du 06/09/2022 au 08/09/2022
Le parcours CAC
Le parcours CAC des Universités d'été 2022 de la profession comptable francilienne

du 08/09/2022 au 08/09/2022
Séminaire Fiscal et Patrimoine (Jeudi 8 septembre 2022)
Le séminaire traite des sujets techniques liés à la fiscalité et au patrimoine, permet d’améliorer vos compétences pour les transformer en missions

du 08/09/2022 au 08/09/2022
Séminaire Jeunes inscrits (Jeudi 8 septembre 2022)
Ce séminaire s’adresse aux jeunes inscrits à l’Ordre des experts-comptables.
Les ateliers sont entièrement dédiés aux problématiques d’installation et des premiers développements du cabinet : stratégie d’offre et de marketing, recherche de notoriété, recrutement et fidélisation, relations clients, réseau confraternel.
Les ateliers sont entièrement dédiés aux problématiques d’installation et des premiers développements du cabinet : stratégie d’offre et de marketing, recherche de notoriété, recrutement et fidélisation, relations clients, réseau confraternel.

07/09/2022
Séminaire Stagiaires (Mercredi 7 et jeudi 8 septembre 2022)
Avec plus de 4 000 stagiaires, l’Île-de-France compte le plus grand nombre de futurs experts-comptables en France. Plusieurs centaines d’entre eux viennent se former lors des Universités d’été. Ce séminaire leur est dédié.

07/09/2022
Séminaire Transmission (Mercredi 7 septembre 2022)
Transmettre ou reprendre une entreprise n’est jamais simple. Pourtant il existe de nombreux accompagnements et différentes méthodes à votre disposition pour accompagner vos clients cédants ou repreneurs.

07/09/2022
Séminaire de la Transformation - Spécial experts-comptables (Mercredi 7 septembre 2022)
L’automatisation des tâches comptables traditionnelles et la généralisation de la facture électronique entraînent de grands changements dans les cabinets.

06/09/2022
Séminaire de la Transformation – Spécial collaborateurs (Mardi 6 septembre 2022)
Transformer son cabinet, c’est bien. Mais sans ses collaborateurs, inutile d’espérer mettre en œuvre sa nouvelle stratégie.

06/09/2022
Séminaire Paye, social et RH (Mardi 6 septembre 2022)
De nombreux collaborateurs se consacrent à cette mission très développée en cabinet. Elle nécessite des connaissances réglementaires pointues et des mises à jour fréquentes.

06/07/2022
Depuis 32 ans, les Universités d’été accompagnent les évolutions de la profession comptable et se transforment avec elle
Edito du spécial hors-série francilien consacré aux Université d'été 2022

06/09/2022
Espace d’exposition
Avec un espace d’exposition de 930 m2, réunissant l’ensemble des partenaires et institutions de la profession, les Universités d’été vous permettent de (re)découvrir au même endroit toutes les solutions à votre disposition pour faciliter votre quotidien et booster la performance de votre cabinet.
1
2